
Nouveau témoignage dans notre série « Les cours qui marchent » : les Sydologues se souviennent de professeurs qui les ont marqués – en bien ! – et essaient rétrospectivement de comprendre pourquoi. Cette fois-ci, c’est Aurélien qui évoque ses années lycée.
La marge à droite
En seconde, notre professeur de français était loin de faire l’unanimité au sein du lycée. Je me souviens d’avoir suscité, en faisant à la rentrée la liste de mes profs à mes amis de première ou de terminale, des réactions du type :
– « Ah t’as monsieur Bidule ! trop nul, vous allez rien faire ! »
– « Ahah il est trop chelou tu vas voir ! »
– « Je te plains : j’ai passé un an au fond de la classe à rien comprendre moi »
– ou encore « Monsieur comment ? je l’ai eu je crois mais je le confonds toujours avec le prof de SVT ».
Ça avait l’air mal barré…
Et puis l’année a commencé. Le type en question était effectivement un drôle d’oiseau : il délaissait avec une désinvolture assumée le « programme » de seconde et le manuel que nous avions laborieusement récupéré au CDI, ne semblait suivre aucune progression pédagogique véritable et paraissait être perpétuellement en train d’improviser, gardant la parole la plupart du temps, et nous mettant rarement en activité. C’était peu conventionnel.
Pourtant je n’arrivais pas à le trouver mauvais et j’allais toujours en cours de français avec plaisir. Il abordait des sujets variés, parlait d’amour, de sentiments, d’émotions, de citoyenneté, commentait l’actualité. Il nous poussait à nous abonner au Monde en nous expliquant que nous devions être toujours au courant de ce qui se passait, et à en feuilleter chaque semaine le supplément consacré à la littérature. Il nous encourageait à aller flâner en librairie pour lire les quatrièmes de couverture des ouvrages qui paraissaient, quel que soit leur sujet.
J’étais de plus en plus enthousiaste – et de plus en plus seul à l’être : mes camarades se souviennent encore aujourd’hui du « manque de sérieux » du personnage et de son incapacité à donner un cadre aux élèves ou à les faire réellement progresser. J’aimais sa manière de faire des sciences humaines, de donner à travers la sienne la parole aux auteurs qu’il affectionnait particulièrement pour qu’ils nous entretiennent de thèmes universels et interrogent notre vision du monde : nous avons ainsi étudié Montaigne, Racine ou Chateaubriand, de grands classiques avec lesquels il dialoguait par l’intermédiaire des études de textes comme s’ils avaient été nos contemporains. Il faisait des ponts entre leurs siècles et le nôtre, et fut le premier à me faire comprendre que les hommes ont toujours été des hommes et le seront toujours, avec les mêmes sentiments, les mêmes désirs et les mêmes interrogations.
Dans son approche de dilettante, quelque chose m’appelait. Je me suis mis à lire la presse, à fréquenter les librairies ; j’ai dévoré avec passion toutes les tragédies de Racine, mis le nez dans Montaigne (avec moins de succès), considéré d’un œil nouveau les ouvrages qui composaient la bibliothèque paternelle.
Qu’est-ce qui marchait avec moi ?
En premier lieu le fait que les cours de cet énergumène ne ressemblaient à aucun de ceux que j’avais déjà suivis : en entrant en seconde, on est déjà rompu aux usages scolaires et l’on participe avec plus ou moins d’implication au ronronnement des leçons, des exercices et des interrogations. Dans ce contexte rébarbatif, les cours de français détonnaient.
Tous les vendredis, nous avions par exemple une interrogation de vocabulaire un peu particulière : chaque semaine, nous devions apprendre les définitions de 10 nouveaux mots, tirés d’un petit livre redoutable (« 1000 mots pour réussir », le titre était ambitieux). Au bout d’un mois, nous étions donc déjà censés avoir mémorisé une quarantaine de ces 1000 mots (superfétatoire, roboratif, prérogatives, cécité, c’était pas de la tarte aux pommes).
Tous les vendredis, il en choisissait 10 parmi ceux-ci, et nous devions non pas en donner simplement les définitions, mais les utiliser dans un texte de notre composition, cohérent du début à la fin, et permettant de montrer que nous avions compris et retenu le sens de ces mots. Nous passâmes ainsi une heure de cours par semaine à nous battre avec eux. C’était un exercice extrêmement difficile, mais que j’avais trouvé d’emblée très excitant : j’attendais ces interrogations avec beaucoup d’impatience, je m’amusais beaucoup à essayer de dompter ces mots nouveaux – et tous se rangeaient définitivement dans mon esprit, au milieu des tips de jeux vidéo, des accords de guitare et des silhouettes de mes plus jolies camarades.
Mais c’est certainement sa manière de laisser de côté les contraintes scolaires pour s’adresser à nous comme à des adultes qui, paradoxalement, a fait mouche pour moi. Ce n’était pas un professeur comme les autres, et il n’abordait pas sa matière comme les autres professeurs non plus. Il en jouait d’ailleurs : il nous expliqua en début d’année qu’il était absurde de faire écrire les élèves sur des copies avec une marge à gauche lorsqu’on était un professeur droitier, puisqu’il était logique qu’on pût inscrire ses annotations en face du texte corrigé sans avoir à poser sa main dessus. Il nous demanda donc de prendre définitivement nos feuilles à l’envers quand nous avions des travaux à lui rendre.
Cultiver la surprise et l’originalité, être à contre-courant, remettre en question la doxa : et si c’était ça, aussi, être pédagogique ?
Voici les liens des autres articles de cette série :
– Les cours qui marchent #1 – Le biologiste artiste
– Les cours qui marchent #2 – L’économiste infiltré
– Les cours qui marchent #3 – La marge à droite
– Les cours qui marchent #4 – Le codeur allumé
– Les cours qui marchent #5 – L’Histoire incarnée
– Les cours qui marchent #6 – Païssagoreusse
– Les cours qui marchent #7 – Le prof pas comme les autres
– Les cours qui marchent #8 – Les outils détournés
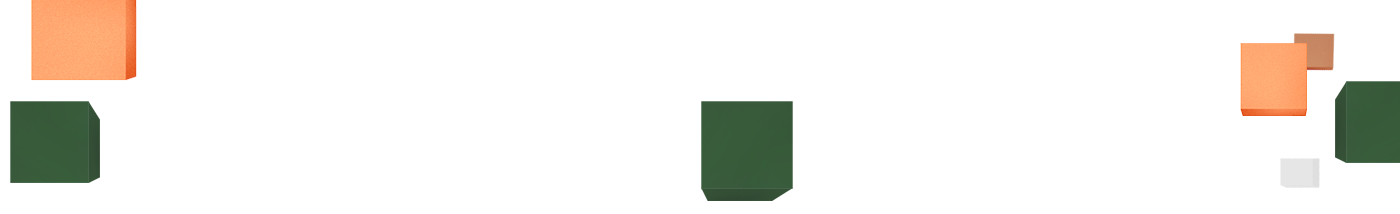
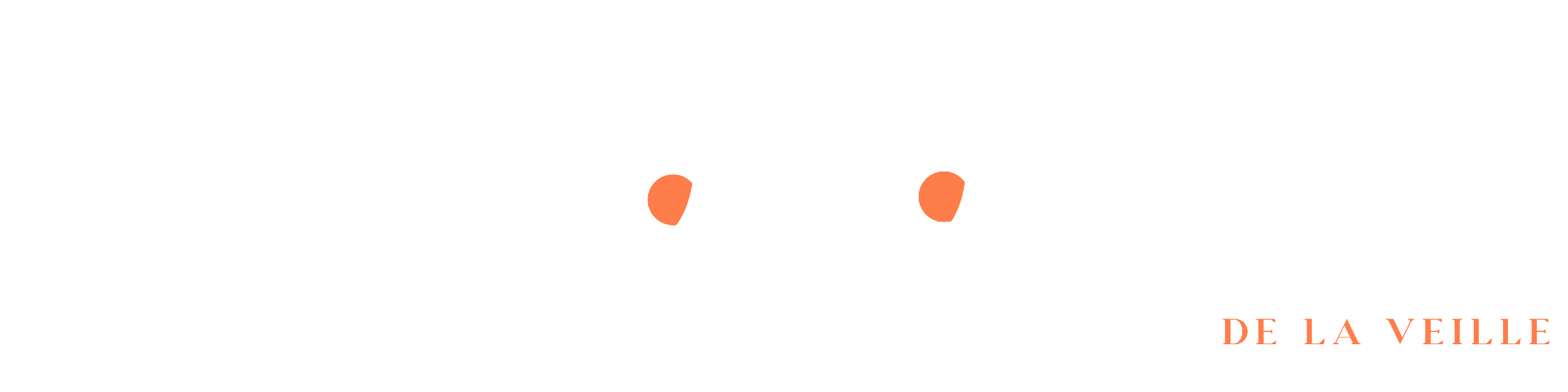



Un commentaire
Merci, l’article est très intéressant… mais aussi risqué : on apprend dès l’entame qu’un seul élève a vraisemblablement adhéré à la stratégie pédagogique de ce prof. On découvre avec plaisir ses méthodes singulières, mais en sachant déjà que leur succès est/fut moins que relatif. Je crois qu’un des défis de la pédagogie est -là où adaptativité et/ou individualisation sont impossibles- de réussir à rassembler malgré la vertigineuse disparité dans la réceptivité des apprenants.