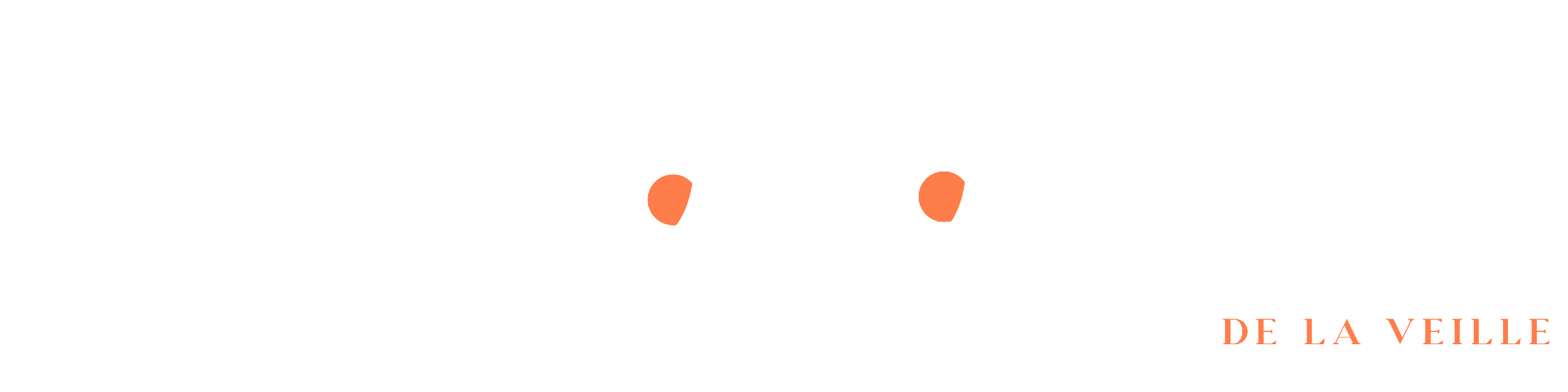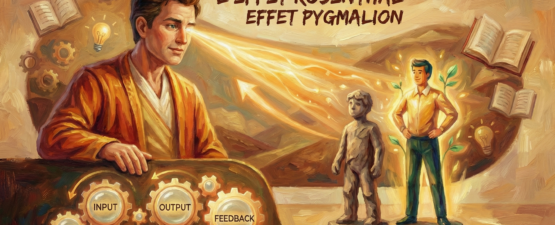… c’est bien plus que ça
Faisons une petite expérience : regardez cet emoji « 😊 ». En une fraction de seconde, votre cerveau a non seulement reconnu un visage, mais aussi décodé une émotion positive. Tout ça à partir d’une image : fascinant, n’est-ce pas ? Bon, j’avoue que je trouve tout fascinant…
Cette capacité que nous avons tous à comprendre instantanément certaines images me laisse toujours admiratif (quand même, un smiley, c’est juste des pixels, c’est fou non ?). Des panneaux routiers qui nous guident sans même y penser, aux interfaces de nos applications qui nous semblent si naturelles, notre quotidien est tissé de signes visuels que nous déchiffrons sans effort. Du moins, en apparence… Essayons de comprendre tout ça.
Des grottes à l’écran : l’évolution de notre rapport à l’image
Il y a plus de 40 000 ans, nos ancêtres utilisaient déjà les images pour transmettre des informations vitales : zones de chasse, dangers, techniques de survie. Cette utilité pratique de l’image et des signes visuels n’a fait que s’amplifier et s’élargir. Des pictogrammes sumériens servant à comptabiliser les récoltes aux QR codes qui donnent accès à nos billets de train, quelle évolution ! Mais comment notre cerveau arrive-t-il à donner du sens à tout ça ?

Notre cerveau, une machine à interpréter l’image
Commençons par le plus fondamental : comment percevons-nous les images ? Au début du XXe siècle, les psychologues de la Gestalt ont fait une découverte fascinante (oui, encore !) : notre cerveau ne se contente pas de recevoir passivement l’information visuelle, il l’organise activement selon des lois précises.
Prenez une suite de points : ••••. Vous les voyez probablement alignés, groupés. Ces lois de perception (continuité, proximité, similitude) sont universelles et constituent la base de notre compréhension visuelle.
Mais la perception n’est que le début de l’histoire. Une fois que notre cerveau a organisé l’information visuelle, comment lui donne-t-il du sens ? C’est là qu’interviennent différents niveaux d’interprétation.
De la forme au sens : les différentes couches de lecture
Le sémiologue Charles Sanders Peirce nous aide à comprendre comment une même image peut porter plusieurs niveaux de sens. Prenons l’exemple du feu rouge :
– Premier niveau (l’icône) : nous reconnaissons simplement la forme et la couleur.
– Deuxième niveau (l’indice) : nous comprenons qu’il signale une intersection.
– Troisième niveau (le symbole) : nous savons qu’il représente l’obligation d’arrêt.
Cette compréhension en couches explique pourquoi certaines images sont si efficaces : elles activent simultanément plusieurs niveaux de lecture dans notre esprit.
L’intuition au service de la compréhension
Mais il y a plus fascinant encore (je vous avais prévenu, et je ne compte pas arrêter…). James Gibson a découvert que certaines formes suggèrent naturellement leur utilisation – c’est ce qu’il a appelé « l’affordance ». Don Norman a ensuite montré comment ce principe s’applique au design numérique.
C’est pour ça que l’icône de corbeille sur votre ordinateur vous « dit » instantanément qu’elle sert à supprimer des fichiers, même si c’est la première fois que vous utilisez un ordinateur !
Des images universelles aux interprétations culturelles
Cette capacité à comprendre intuitivement certaines images va encore plus loin. Carl Jung a théorisé l’existence d’archétypes, des images qui semblent parler à tous les humains, quelle que soit leur culture.
Le cercle, par exemple, évoque universellement la perfection et la totalité, de la pleine lune aux mandalas. Les publicitaires l’ont bien compris : regardez les logos des grandes marques, vous y retrouverez ces formes archétypales.
Mais attention ! Roland Barthes nous rappelle que notre interprétation des images n’est pas que biologique ou intuitive. La culture joue un rôle crucial. Un même symbole peut avoir des significations très différentes selon les contextes culturels. La colombe, symbole de paix en Occident, peut être interprétée différemment ailleurs.
Image et sens : les défis de l’ère numérique
Revenons à notre emoji du début. Aujourd’hui, en quelques clics, n’importe qui peut créer, modifier et partager des images. Les technologies numériques nous offrent une liberté créative qui aurait semblé magique à nos ancêtres des grottes de Lascaux. Applications de création graphique, outils de visualisation de données, intelligence artificielle générative… notre boîte à outils ne cesse de s’enrichir.
Mais cette abondance de moyens nous ramène à une question essentielle : comment choisir la représentation qui touchera vraiment notre public ?
La responsabilité du créateur visuel
Car oui, avec cette profusion d’outils, créer une image n’est plus vraiment un défi technique. Le véritable enjeu est ailleurs : comment s’assurer que notre message visuel atteindra son but ?
Qu’il s’agisse d’une infographie pour expliquer le changement climatique, d’un schéma pour faciliter l’apprentissage, ou d’une interface pour guider l’utilisateur, chaque choix visuel influence la façon dont notre message sera compris et retenu.
Prenez ces nouveaux outils d’intelligence artificielle qui peuvent générer des images impressionnantes en quelques secondes. Mais un simple croquis sur un coin de table peut parfois être plus efficace pour faire comprendre une idée. C’est comme notre emoji du début : sa force ne vient pas de sa complexité technique, mais de sa capacité à transmettre instantanément une émotion.
Image et sens : conclusion
De l’emoji souriant aux visualisations de données complexes, notre rapport aux images continue d’évoluer. Mais une chose reste constante : la vraie puissance d’une image réside dans sa capacité à créer du sens, à toucher, à faire comprendre.
Alors que nous entrons dans cette ère d’abondance visuelle, peut-être que le plus grand défi n’est pas de créer toujours plus d’images, mais de créer celles qui sauront vraiment parler à notre public, comme ce simple emoji qui a ouvert notre discussion.
On se voit la semaine prochaine pour l’épisode 2 :).
Pendant ce temps, si vous voulez creuser la question, vous pouvez lire cet article sur le design émotionnel.