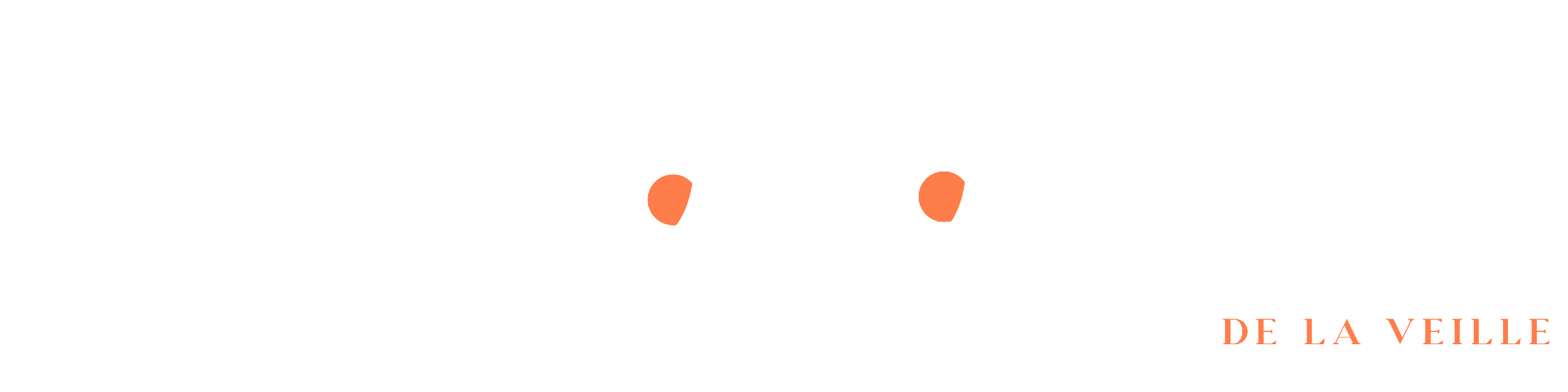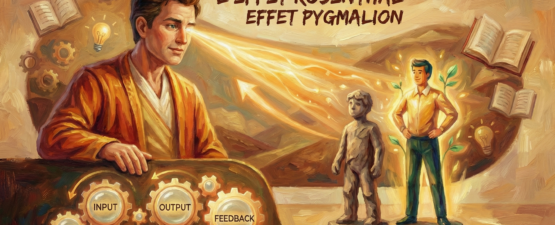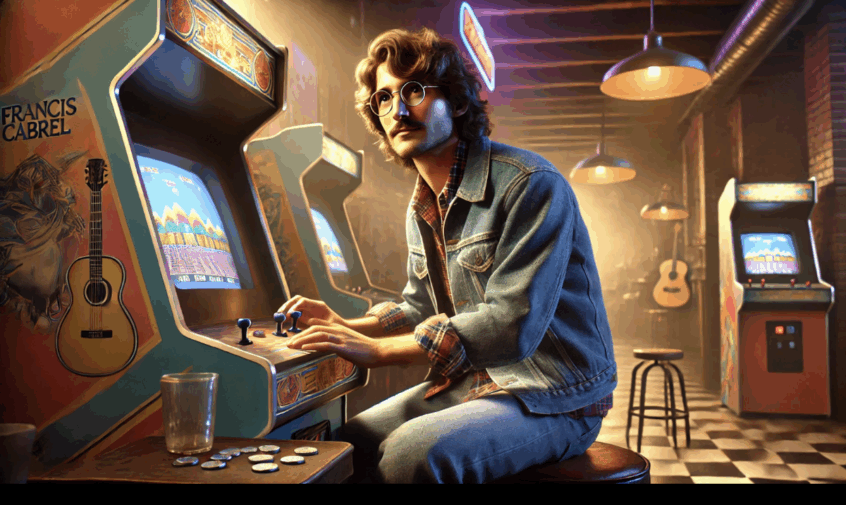
Dans le précédent article, nous avons vu que le jeu pédagogique stimule motivation, attention et interaction, mais il doit être bien conçu et utilisé à bon escient pour ne pas devenir contre-productif. Aujourd’hui, penchons-nous sur les différents niveaux de gamification (ou ludification pour les allergiques à l’anglais).
Nous avons tous une relation particulière avec les jeux. Certains préfèrent suivre les règles sans se poser de questions, d’autres préfèrent avoir un minimum de choix pour se sentir maître du jeu, sans se sentir dépassés par un jeu trop complexe et nécessitant de multiples prises de décision, et, enfin, les plus audacieux rêvent de tout contrôler et de réinventer les règles.
Peu importe à quelle catégorie vous appartenez, une chose est certaine : le jeu, quand il est bien conçu, a ce petit quelque chose qui nous séduit tous.
Dans cet article, on va explorer les différents niveaux de gamification et leur influence sur l’engagement du joueur. Spoiler alerte : les mécaniques les plus simples peuvent capter l’auditoire et donc favoriser l’apprentissage autant que des mécaniques plus riches.
Alors, prêts à jouer ?
Les niveaux de gamification et l’engagement
La gamification, ou l’utilisation des mécaniques issues des jeux dans des contextes de formation, aide à augmenter l’engagement des utilisateurs.
Dans le cadre des jeux pédagogiques, elle peut prendre différentes formes selon le degré de liberté accordé au joueur, les facteurs sur lesquels les joueurs peuvent jouer, les choix qu’ils ont à faire et l’impact de leurs choix sur le déroulement du jeu. Pour évoquer ce concept, nous avons créé trois niveaux différents de gamification, avec un degré croissant de player agency (liberté d’action du joueur).
Il s’agit de comprendre comment ces différents niveaux ont une influence sur l’engagement tout en conservant les objectifs pédagogiques poursuivis.
Pour illustrer ce concept, on prendra comme exemple un jeu fictif où on chercherait à transmettre des notions relatives au tri des déchets. Voici les trois niveaux de gamification imaginés pour ce type de jeu :
– Jeu t’aimais : pas ou peu de modification possible. Les actions du joueur et leurs implications suivent un chemin linéaire avec des interactions limitées mais qui peuvent toujours être engageantes, si les mécanismes sont bien conçus.
→ Exemple : cliquer sur la bonne poubelle lorsqu’un déchet apparaît, afin de le trier.
– Jeu t’aime : modifications limitées ou contraintes. Les joueurs peuvent choisir parmi un ensemble d’options limitées, influençant légèrement le déroulement du jeu, tout en restant dans un cadre prédéfini.
→ Exemple : supposons maintenant que nous avons un jeu de tri qui a lieu dans une ville fictive. Ce jeu contient plusieurs défis comme trier rapidement les déchets, organiser une collecte communautaire ou optimiser le tri dans une usine. Pour augmenter la gamification, le joueur pourrait choisir l’ordre des défis, avec un impact sur la stratégie ou les scores globaux de la ville.
– Jeu t’aimerai : modifications significatives et ouvertes. Le joueur dispose d’une grande liberté et peut affecter profondément le déroulement du jeu ainsi que sa fin, en fonction de ses décisions.
→ Exemple : sur le même jeu de tri que l’exemple précédent, le joueur pourrait débloquer des niveaux bonus en fonction de sa performance dans le jeu, choisir l’ordre des défis et avoir une fin de jeu différente en fonction des choix.
Il est important de souligner que l’engagement ne dépend pas uniquement de la complexité de ces niveaux.
Un système minimaliste, bien conçu, peut offrir une profondeur émotionnelle et stratégique inattendue. Par exemple, des jeux comme Flappy Bird, avec une interaction simple de juste appuyer sur l’écran n’importe où et au bon moment, illustrent comment des interactions simples peuvent susciter un fort engagement du joueur.
Ainsi, la réussite d’une gamification ne réside pas forcément dans la sophistication des interactions ou des mécanismes de gameplay supplémentaires, mais dans la manière dont elles servent les objectifs du jeu et résonnent chez le joueur. Pour illustrer ce concept, prenons l’exemple du jeu Reigns.
Le jeu Reigns : simplicité et engagement
Dans le jeu Reigns, le joueur incarne un roi ou une reine qui prend des décisions en glissant des cartes à gauche ou à droite, un mécanisme assez minimaliste qui repose sur :
– Une perception d’impact : chaque décision influe sur quatre paramètres (population, église, armée et trésor), représentés par des jauges plus ou moins remplies, créant un sentiment de responsabilité malgré l’apparente simplicité des actions.
– Des boucles d’apprentissage : le joueur apprend les conséquences de ses choix par essais et erreurs, ce qui renforce l’engagement et incite à rejouer pour améliorer ces décisions.
– Une narration dynamique : l’histoire se déroule en fonction des choix, donnant l’impression que le joueur façonne l’intrigue, même si les possibilités restent encadrées.
Le jeu Reigns illustre ainsi parfaitement que la simplicité d’un mécanisme n’est pas un frein à l’engagement du joueur. Parmi les niveaux de gamification que nous avons étudiés, ce jeu peut être considéré comme relevant du niveau 3.
Passons maintenant à l’application de ces idées dans le contexte éducatif.
Application aux jeux pédagogiques
Sur un jeu éducatif comme un jeu sur le tri des déchets, il est possible de s’inspirer d’une approche comme celle du jeu Reigns en utilisant des mécaniques simples mais engageantes :
– Proposer un système où chaque action (mettre un déchet dans la bonne poubelle) a un effet immédiat visible sur un indicateur global (par exemple, la propreté d’un quartier ou un compteur de points totaux).
– Ajouter des boucles d’apprentissage qui, rappelons-le, désignent un processus interactif dans lequel un joueur fait des choix, en observe les conséquences, puis ajuste ses actions en fonction des résultats obtenus sans être surchargé par des options complexes.
– Intégrer une progression narrative ou des défis thématiques pour maintenir l’intérêt, même si le gameplay reste minimaliste.
Par exemple, nous pouvons penser à un jeu pédagogique pour apprendre la chimie où le joueur incarne un jeune apprenti alchimiste explorant un monde fantastique pour percer les mystères de la matière.
À travers une progression narrative, chaque chapitre se concentre sur un concept clé de la chimie : les états de la matière, les réactions chimiques ou encore le tableau périodique des éléments.
Les défis incluent des mini-jeux d’association d’éléments pour créer des composés, des puzzles pour équilibrer des équations chimiques, ou des épreuves de tri pour classer les substances selon leurs propriétés (acides, bases, métaux, non-métaux).
Avec ces mécanismes de gamification le jeu combine apprentissage scientifique et aventure immersive.
Niveaux de gamification et pédagogie
En résumé, un jeu pédagogique peut avoir un mécanisme simple tout en offrant un engagement fort si le joueur perçoit que ses actions ont un impact significatif sur le système ou la progression. Ce n’est pas forcément la complexité des interactions qui importe, mais la clarté des conséquences et le sentiment de maîtrise qu’elles procurent.
On se retrouve la semaine prochaine pour davantage creuser ces trois niveaux avec des exemples concrets de jeux dits “classiques” et de jeux dits “pédagogiques”.
Illustration réalisée via ChatGPT.
cerveau, formation, gamification, jeux, Jeux pédagogiques, ludification